Restez informés
Inscrivez-vous à notre newsletter. Vous recevrez par la suite nos nouveautés et informations.


Traduction du grec moderne et préface par Gilles Ortlieb.
La traduction a reçu le prix Nelly Sachs en 1994.
300 pages I 10,7 x 17 cm
ISBN 978-2-35873-215-4
 Me prévenir à parution
Me prévenir à parution
L’écrivain grec Georges Séféris est né à Smyrne en 1900, dont il sera chassé, comme toute la population grecque qui vivait encore en Asie mineure, par les Turcs en 1922. Après des études de droit à Paris, où il s’imprègne de culture française (Valéry, Gide), il fera carrière dans les services diplomatiques jusqu’à sa nomination au poste d’Ambasssadeur de Grèce à Londres en 1957. Toute son œuvre poétique – nourrie aussi bien aux sources antiques qu’à la poésie moderniste d’un T. S. Eliot (qu’il traduira en grec) – méditera sur cette perte aussi bien que sur celle du prestigieux passé d’un pays aux statues brisées, dont les habitants semblent condamnés, sans cesse, à un douloureux exil.
La récente parution de la monumentale édition de son journal intégral (Journées 1925-1971), aura permis aux lecteurs de langue française de se faire enfin une idée de l’ampleur du personnage qu’il s’agisse du poète, qui fut le premier auteur grec à recevoir le prix Nobel de littérature en 1963, ou du témoin privilégié qu’il fut, aux différents postes qu’il occupa, de tous les événements qui ont marqué l’histoire de la Grèce du siècle dernier.
Roman
Il nous semble donc opportun d’élargir encore son audience en faisant passer en collection de poche, son unique roman, Six Nuits sur l’Acropole, un livre de jeunesse, esquissé dans les années 1920, mais réécrit dans la fièvre vingt-cinq ans plus tard par Séféris alors qu’il était en poste au Liban dans les années 1950 et qu’il ne se sera jamais résolu à publier de son vivant, peut-être parce qu’il craignait d’y avoir révélé trop de lui-même. Sept jeunes gens, parmi lesquels Stratis, l’alter ego de l’auteur, s’y cherchent, perpétuellement tiraillés entre la grandeur passée de la Grèce et leur refus de la réalité présente d’Athènes, entre leurs rêves d’absolu et l’omniprésente sensualité à laquelle les invitent, en ce début de 1928, la grande ville et leur « croyance à la toute-puissance du corps » (comme il est dit dans un poème de 1941). Ils forment le projet de se réunir chaque nuit de pleine lune sur l’Acropole, avec l’espoir – illusoire dans l’Athènes « rétrécie » des années vingt – d’y puiser « la force de leurs ancêtres immortels ». Le projet échouera, bien sûr, mais nul besoin de connaître déjà l’œuvre poétique de Séféris, pour être séduit par ce portrait hachuré d’une poignée de jeunes gens en quête de cohésion et s’ébrouant dans une bohême qui nous semble encore assez neuve. Comme l’écrit le traducteur : « On peut lire ces Six Nuits sur l’Acropole comme un divertissement romanesque et moins juvénile qu’il n’y paraît, y chercher le portrait d’une ville et d’une génération où affleureraient aussi les réalités de l’époque, ou encore prêter à ce livre, sous le patronage de Dante qui introduit ce récit d’une jeunesse revisitée et l’éclaire de nouveau à la toute fin, des significations insoupçonnées. On y retrouvera dans tous les cas cette manière propre à l’auteur de s’attacher à tous les aspects du réel, jusqu’aux plus prosaïques, pour tâcher d’en entendre et d’en dégager le sens. »
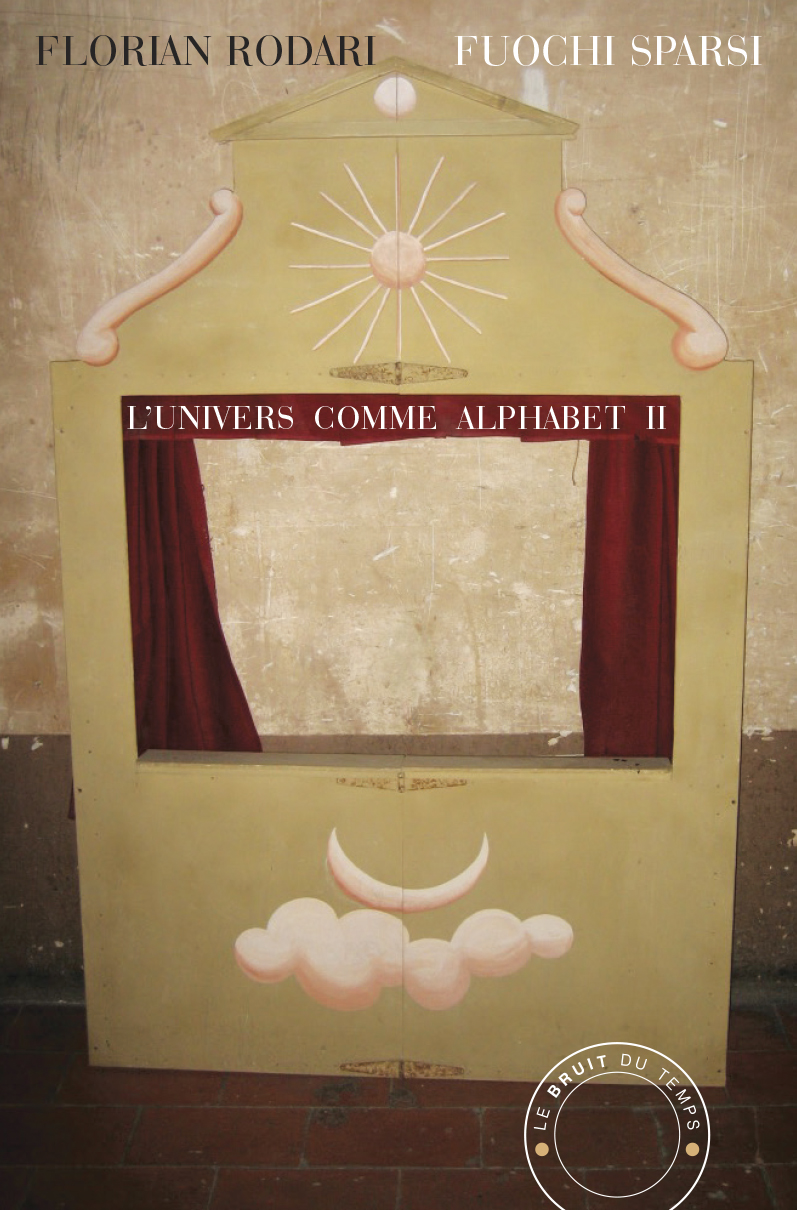

320 pages env., une vingtaine d’illustrations
13,5 x 20,5 cm
ISBN 978-2-35873-214-7
32 €
 Me prévenir à parution
Me prévenir à parution
Écrits
Historien de l’art et commissaire d’exposition, Florian Rodari, qui débuta très tôt sa carrière au Cabinet des estampes de Genève, avait réuni aux éditions Gallimard, il y a bientôt dix ans, une partie de ses essais sur l’art, mais en limitant son choix à ceux qui traitent du domaine de sa compétence première, c’est à dire au dessin, à la gravure et à la photographie, et donc au domaine du noir et blanc. Albane Prouvost, qui signe l’avant-propos de ce nouveau livre, l’a incité à réunir une grande part de ses autres écrits, d’origine et de dates très diverses. Ainsi, de Balthus à André Volkonski, l’univers déchiffré s’élargit-il aux violences somptueuses des couleurs de Bram van Velde, à « l’irruption de l’inconnu » dans la voix d’Angelika Kirchschlager, à « l’onde de choc » que provoque chez lui la poésie de Jacques Dupin. Et donc à la peinture, à la musique, à la littérature et, au-delà-même des œuvres, aux êtres et aux lieux qui ont été des rencontres capitales ; à tous ces foyers lumineux qui, au cours d’une vie, sont venus nous faire signe, « nous avertir de la présence encore voilée d’une vérité essentielle que pour rien au monde il ne faudrait laisser échapper. »
Comme le note la préfacière, « les textes réunis dans ce livre n’obéissent pas à un projet mais à une logique intérieure très ferme, à un feu intérieur qui dessine en creux une vision exigeante de l’art, de la poésie autant qu’un portrait de l’auteur en jeune homme ardent. » Et n’est-ce pas, en effet, comme elle le laisse entendre, marcher sur la tête que de vouloir encore, l’âge venu, rester dans cet état d’émerveillement que l’on a éprouvé, enfant, en voyant pour la première fois s’ouvrir le rideau rouge du théâtre guignol, et de s’obstiner, avec le même enthousiasme juvénile, avec la même attention exigeante, à en déchiffrer fidèlement, avec les mots les plus justes, le mystère ?


Édition bilingue.
Traduction et appareil critique de Jean-Claude Schneider et Anastasia de La Fortelle.
Suivis de « L’exil à Voronej » par Natalia Chtempel
240 pages I 10,8 x 17,8 cm
Collection « Poésie en poche », n° 5
ISBN 978-2-35873-202-4
13 €
 Me prévenir à parution
Me prévenir à parution
LE DERNIER RECUEIL DE POÈMES DE MANDELSTAM
En juin 1934, après avoir été envoyé en relégation à Tcherdyn et interdit de séjour dans les douze villes les plus importantes de Russie, Mandelstam, en compagnie de son épouse Nadejda, finit par choisir de résider à Voronej, petite cité universitaire de province à 500 km au sud de Moscou. Ils sont tous deux en mauvaise santé et lui n’a pratiquement plus aucun moyen de subsistance. Il parviendra néanmoins à effectuer quelques travaux pour le théâtre de la ville et la radio locale. Contraints à de fréquents déménagements, ils vivent presque totalement isolés, ne voyant guère qu’une jeune femme dont ils ont fait la connaissance, Natalia Chtempel, qui a le courage de les fréquenter — et dont nous publions en annexe les précieux souvenirs qu’elle a gardés de cette époque de la vie du poète. Et cependant, c’est dans ce pays de terre noire, où il y a tout de même une petite vie culturelle (des concerts, un cinéma), et où il lui reste bien sûr quelques livres
(Villon, Dante, Goethe, les poètes espagnols poursuivis par l’inquisition et dont il apprend la langue) que va naître une explosion de poèmes magnifiques, qui seront notés dans trois petits cahiers d’écolier, d’où leur titre. Ces poèmes reprennent une formule de composition utilisée dans les recueils précédents, ils s’ordonnent en suites, en cycles, autour d’un même thème ressassé. Ils récitent un journal poétique de l’exil intérieur, saturé d’allusions, de citations tacites, de réminiscences, ils sont le témoignage d’un poète enterré vivant dont les lèvres murmurent encore, et donnent à entendre une musique du quotidien où l’usure de la vie est comme audible, où le moi s’efforce de remonter respirer à la surface. Le poème révèle même ses propres tâtonnements : la recherche d’un parler plus simple, capable de toucher les masses, de les réveiller, la tentation de délaisser la parole obscure pour un discours plus aisément compréhensible, afin de renouer ainsi avec la vieille tradition de la poésie russe. Flotte maintenant dans l’air que respire le poète, à côté de l’amertume liée au sort que le temps lui impose, le désir de se réfugier aux rivages du Sud, dans les contrées d’autres Colchide ou Tauride visitées par le rêve. Ainsi mentionne-t-il, en écho au Wilhelm Meister de Goethe, la figure de Mignon habitée par la nostalgie du « pays où fleurit le citronnier ». Et, pour marquer encore la coloration sereine de trop fugitifs moments, le tout dernier cycle, hanté par la présence bénéfique de quelque femme aimée, articule le mot final « promesse ». Mandelstam et Nadejda quittent la ville le lendemain de la fin de leur relégation, le 16 mai 1937, mais le « miracle » de Voronej aura eu lieu : la centaine de poèmes ici réunis.
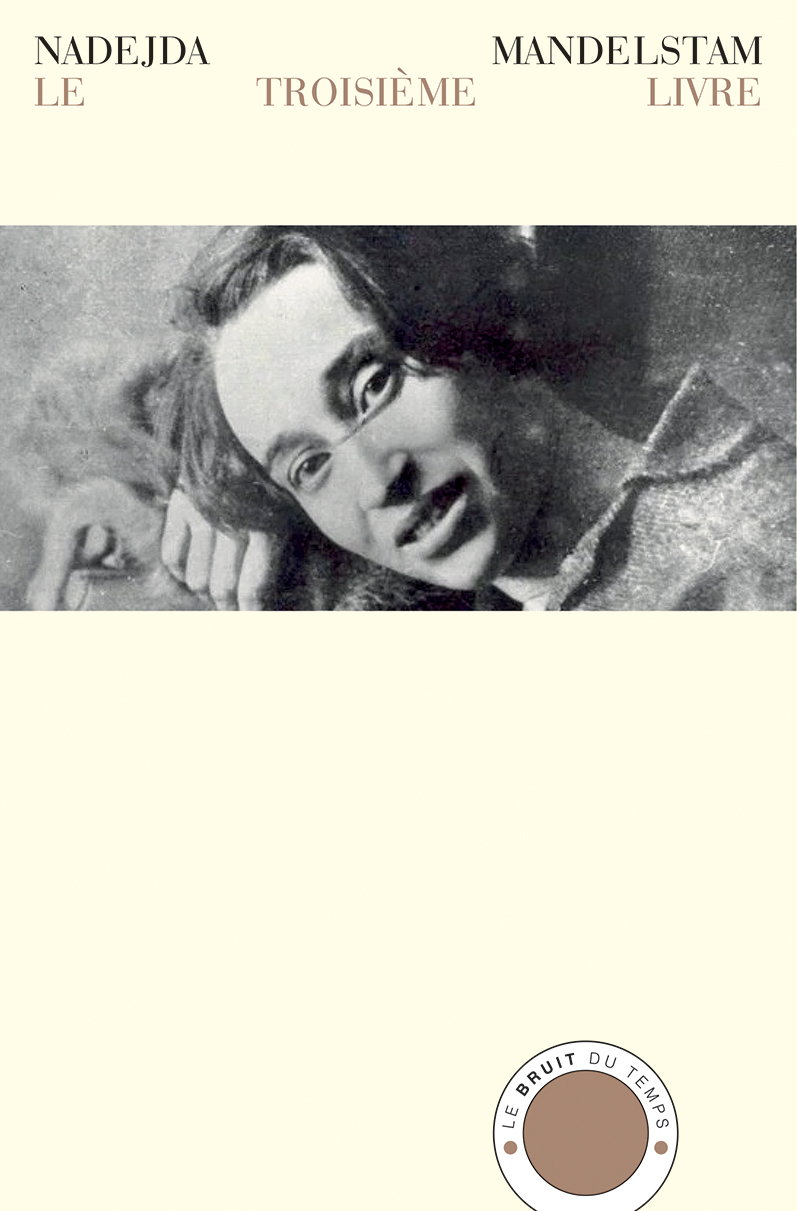

Traduit du russe et présenté par Anastasia de la Fortelle et Jean-Claude Schneider.
Le dernier volume des Mémoires, inédit en français.
360 pages I 13,5 x 20,5 cm
ISBN 978-2-35873-201-7
26 €
 Me prévenir à parution
Me prévenir à parution
Nadejda Mandelstam (1899-1980), en publiant dans les années 1970 les deux volumes de ses Mémoires (ils parurent en français, sous le titre Contre tout espoir, en trois volumes aux éditions Gallimard) révéla en Occident l’importance de l’œuvre de son mari, et ce que fut son destin tragique. Elle aurait pu estimer alors avoir achevé la tâche qu’elle s’était fixée en tant que « témoin de la poésie ». Elle a pourtant pensé devoir compléter son œuvre de gardienne avec la rédaction d’un troisième livre qu’elle n’a pu terminer avant sa mort et qui n’a vu le jour qu’en 2006, grâce à l’attention d’un groupe d’amis, au nombre desquels Ivanovna Stoliarova, longtemps détenue au Goulag et amie et soutien de nombreux écrivains persécutés. Dans ce nouveau volume, à côté de souvenirs évoquant sa famille, son enfance et son adolescence jusqu’à sa rencontre avec celui qui deviendra son compagnon de route et de misère, Nadejda Mandelstam montre une fois encore ses talents d’écrivain, de confidente privilégiée et d’exégète perspicace. On lira ici son « testament » : le récit de ses efforts pour sauvegarder l’œuvre du poète qu’elle considérait à juste titre comme l’un des plus grands, voire le plus grand, de son temps, ses revendications en tant qu’héritière, le sort qui a été réservé à sa condition de veuve. Elle retrace ensuite l’historique de ses archives et les démêlés avec les éventuels détenteurs de manuscrits. Une part importante du volume est consacrée aux commentaires des Poèmes de Voronej (qui paraissent parallèlement au Bruit du temps dans la collection « Poésie en poche »). Un essai remarquable, enfin, intitulé « Mozart et Salieri », fait preuve d’une pénétration étonnante chez quelqu’un n’ayant jamais écrit de poésie pour évoquer et décrire le processus de la création du poème : sa naissance dans le murmure intérieur du poète (travaillant de tête, sans écrire), sa maturation vers une forme définitive. L’ensemble de ces textes est complété par une série de lettres adressées à des correspondants étrangers, toujours dans le but de poursuivre la sauvegarde de l’œuvre de Mandelstam.


Traduction du japonais, présentation et notes de Michel Vieillard-Baron
240 pages I 13,5 x 20,5 cm
ISBN 978-2-35873-217-8
24 €
 Me prévenir à parution
Me prévenir à parution
L’autrice
Ukyô no Daibu est née, vers 1152, sans doute à Kyoto, d’un père calligraphe reconnu et d’une mère issue d’une famille de musiciens. Son frère aîné étant lui-même devenu calligraphe auprès de l’homme le plus puissant de l’État, c’est sans doute celui-ci qui devint le protecteur de la jeune fille et l’introduisit au palais. Elle devint dame d’honneur et, en 1173 entra au service de l’impératrice Kenreimon-in. Calligraphe elle aussi, dès l’âge de 13 ans, elle avait participé et contribué à des réunions poétiques, ou à des concours de poèmes qui lui valurent une certaine reconnaissance en tant que poète, et d’écrire même des waka au nom d’autres personnes qui la sollicitaient.
Pour des raisons inconnues, elle quitte la cour en 1178 et l’on sait peu de choses des vingt années qui suivent : sans doute passées chez sa mère ou ses frères. Au cours de cette période, le clan des Taira, (la famille, à laquelle appartenait l’impératrice Kenreimon-in) est en grande partie anéanti ; Taira no Sukemori, l’homme avec qui elle avait noué une relation passionnée et tumultueuse, se suicide (en 1185) ; quant à Kenreimon-in, elle survit mais entre en religion. En 1196, Ukyô no Daibu est rappelée à la cour, d’abord au service de l’empereur Gotoba, puis, pendant de longues années, auprès de la mère de Gotoba, l’impératrice retirée Shichijô-in. Ce sont sans doute les dames d’honneur de cette impératrice qui furent les premières lectrices des Mémoires poétiques. C’est en tout cas à la demande du compilateur d’une anthologie impériale qu’elle mit en forme, vers 1233, son recueil et choisit le pseudonyme qu’elle souhaitait y attacher. Elle avait alors près de 80 ans. Elle meurt en 1235.
L’œuvre
Les Mémoires poétiques telles que nous les lisons aujourd’hui sont la mise en forme, vers 1233, par Ukyô no Daibu elle-même, de ce qu’elle considérait comme le meilleur, le plus représentatif, le plus émouvant, de sa production poétique (on y compte 359 waka) et de ses mémoires. Ukyô no Daibu avait sans doute, à différentes époques de sa vie, compilé des recueils de ses poèmes, mais aussi écrit ses mémoires, trié sa correspondance. Ce sont ces différents documents qu’elle utilisa pour ce livre qui est donc à la frontière de deux genres qui, dans le Japon d’alors, permettent tous deux à un individu de s›exprimer sans fard : le recueil de poèmes (shu) et les mémoires ou notes datées (nikki). Une première partie du livre (jusqu’au poème 203) relate la splendeur de la cour qu’elle a connue dans sa jeunesse puis le grand amour de sa vie, sa relation à la fois heureuse et douloureuse, avec Taira no Sekumori. Ce sont ses souvenirs les plus anciens, évoqués à travers des poèmes qu’elle introduit par des notes puisées dans ses mémoires. Dans la deuxième partie du livre, les faits sont narrés plus chronologiquement et avec plus de précision. Elle y évoque la guerre civile et la fuite des Taira contraints de quitter la capitale en 1183 ; l’annonce de la mort des frères de Sukemori ; le dernier échange de lettres entre Ukyô no Daibu et Sukemori ; l’annonce de la mort de Sukemori (en 1185) ; la visite qu’Ukyô no Daibu fit à l’impératrice Kenreimon-in dans le temple où elle s’est retirée ; son pèlerinage d’Ukyô à Hiyoshi ; la cérémonie religieuse pour l’anniversaire de la mort de sa mère et celle pour l’anniversaire de la mort de Sukemori. Les Mémoires deviennent alors un témoignage unique et bouleversant sur l’une des périodes les plus violentes et les plus sombres de l’histoire du Japon : la guerre civile qui opposa les guerriers Taira aux Minamoto et se solda par l’élimination presque complète, en 1185, des membres masculins de la famille Taira. Ukyô no Daibu y compose un magnifique requiem destiné à maintenir vivant le souvenir des personnes qu’elle a connues.