Poezibao, Note de lecture, par François Lallier
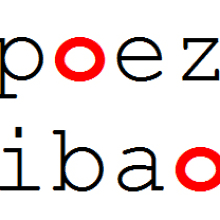
Sous ce titre suggérant un tableau, Le fauteuil jaune, Stephen Romer publie au Bruit du temps une anthologie de ses poèmes, dont la construction, assez complexe, en six sections, ne vise pas seulement à refléter ses intérêts, ou modèles (comme on le dirait d’un peintre), mais, miroir à plusieurs faces, une subjectivité que toutes, si diverses soient-elles, ont en commun – dans un mouvement d’unité qui fait l’un des grands intérêts de ce livre. Les yeux mi-clos, Ordina questo amore, Ateliers, Suite ligérienne, Lares familiares, Âpretés pour après, tels en sont les titres. Elles dessinent à découvert les traits d’une existence, ainsi se trouve relancée de façon originale la question du « sujet » de la poésie. Et elles pourraient répondre au seul choix toujours hasardeux d’une anthologie, si chacune ne se révélait plutôt avoir les traits d’une des figures que la poésie peut prendre, d’un des modes où elle se plaît. Poésie personnelle, sans doute. Mais celle-ci n’est le reflet d’une personne que pour la constituer – c’est la condition du dialogue du poème avec son lecteur, et avec lui-même. De quoi ce livre donne un brillant exemple, qu’éclaire encore l’inhabituel Avant-propos où Stephen Romer fait de la « cristallisation » amoureuse un modèle possible de ce qui se produit dans le poème : moment où se condensent et prennent forme commune la lettre et les moments de l’existence qui se reconnaît en elle.
La première partie – « Les yeux mi-clos » – rattache la cristallisation à la mémoire et à la conscience du temps. C’est le temps qui est en cause, chronos ou kairos, mais aussi la saison, et le lieu, ce qui fuit et ce qui demeure, la permanence et la fin. Dans « Place de la Sorbonne » celui qui voit la fin participe à la permanence d’une jeunesse qui ne vieillit pas, et quand la vision se referme sur des « burning fountains », qui brûlent la nostalgie, pour le regard intérieur prend sens l’idée : « nous avons survécu à nous-mêmes », « we have outlived ourselves ». L’ambiguïté surmontée de ces mots dit l’orientation de tout le livre, et la source de l’énergie qui se rassemble en lui, et le fait tout autre chose que prématurément testamentaire. C’est dans cette façon de « outlive ourselves », de vivre au-delà de nous-mêmes (c’est-à-dire également hors de nous-mêmes), que se déploient alors toutes les autres parties, jusqu’à ces « Âpretés pour après » qui, dans une veine satirique, polémique et critique, placée sous la double protection de Baudelaire et de Pound, parlent d’ailleurs plutôt du présent. Car l’après, le monde d’après, c’est comme présent qu’il faut, poétiquement, le comprendre et le voir.
Le fauteuil jaune appartient donc à la poésie qu’on ne devrait pas appeler lyrique, mais élégiaque, au sens des poètes latins (que Stephen Romer cite parfois) : celui d’une forme délibérée où prévaut la relation amoureuse, en même temps qu’une distance critique avec le monde. Volontiers, par citations et exergues, l’auteur déclare son appartenance à une famille poétique dont l’unité se joue du temps et de l’espace (du côté anglais, Gray, Coleridge, Pound, Eliot, Larkin, français Nerval, Baudelaire, Laforgue, Apollinaire, Valéry, Bonnefoy ; mais aussi Ovide et Catulle, naturellement, et Dante). Cet universalisme sélectif, né avec le « modernisme anglo-saxon », répond parfaitement à l’expérience de « cristallisation » évoquée dans l’Avant-propos, et sur laquelle il est bon de revenir un instant. « Collision de deux mondes dans une disposition des mots sur la page », le monde « extérieur, visible » et « cet autre monde intérieur fait de visions, de subjectivité, de désirs et de souffrances obscures », les cristallisations verbales ont ceci de spécifique qu’elles peuvent atteindre un certain degré de réalité, à partir de quoi elles peuvent exister, telles un objet du monde, « réalité imaginée » dit Reverdy, encore dans le paradoxe, ou plutôt, part ajoutée au « stock of available reality », à la « réserve de réalité disponible », dont a parlé le critique américain R. P. Blackmur. Ainsi peuvent se mêler, sans qu’intervienne la notion si fragile de référent linguistique, la réalité de l’expérience et la réalité de la langue, unité qui est au cœur de la poésie.
Mais « cristallisation », nous l’avons dit, c’est aussi le vocabulaire de l’amour. Avec cette acception stendhalienne une autre face de la personnalité poétique du livre apparaît, confirmant l’idée que Stephen Romer est un représentant absolument moderne, comme Apollinaire le fut en son temps, de la tradition élégiaque, et la seconde partie, « Ordina questo amore, O tu che m’ami », semble bien contenir la matière à partir de laquelle, au fond, tout s’ordonne. Par l’emprunt d’un vers de Jacopone da Todi, Stephen Romer ne craint pas de se dire tributaire des deux versants, profane et « sacré » (les guillemets sont de lui, dans l’Avant-propos), de l’amour, sentis comme ayant même racine. Le « personnage qui figure dans ces poèmes » (et y fait bonne figure), « jeune homme mis à mal » par la beauté multiple et chaque fois singulière, ne perd rien à un humour qui tient à juste distance son échec ambigu, dans le sentiment de la perte (« Une seconde fois perdue ! »), et sans pouvoir décider si celle-ci provient d’une âme insuffisante, des caprices du désir, ou de l’attraction d’un autre amour. Et souvent la « Chimère » est poursuivie sous l’influence d’images peintes – La belle Ferronnière ou l’icône de l’Hodigitria –, qu’approfondit la section Ateliers. Le « Passage du peintre » (qu’on croit une femme) a toute l’ironie d’un « arte povera » qui pourtant produit « l’unité du quadruple » ; « Darshan » (qui parle d’un tableau de Ben Nicholson) montre comment une couleur imprévue captive le « regard affamé » d’un visiteur qui ne cherchait qu’à « prendre la tangente ». Et c’est encore à l’amour mis en son ordre que se rattache la « Suite ligérienne », reflets des bords de Loire, le lieu de vie le plus constant de Stephen Romer, que l’exergue empruntée à Yves Bonnefoy déclare comme le fait « imprévisible », qui « nous replace dans l’indifférence de l’être, nous ouvre celle-ci comme ultime secret », autant dire dans le hasard. Hasard qui n’aura pas empêché que, dans le « pays d’élection », la France, et après Paris, les jardins du Luxembourg, la rue Victor-Cousin, ou du Cardinal-Lemoine, ces bords de Loire soient un « refuge » spirituel, lieu de poèmes aux accents bouddhistes (l’auteur lui-même fournit l’indice), marqués par les saisons, où le moi se minimise dans la conscience de la perte, où corrélativement apparaissent des dieux de lumière et des dragons démoniques – héron blanc ou silure moustachu – un été de basses eaux, où l’original M. Jean, à la face rubiconde, promène des curieux sur le fleuve dans sa toue à un mât, comme un personnage de Hiroshige.
« Stephen Romer est un des rares exemples d’un poète très anglais imprégné profondément d’influences françaises, comme Eliot : le meilleur des deux mondes. » – a dit de lui Anthony Rudolf. Venue de la poésie anglaise, il revendique par exemple l’idée de l’Imagination proposée par Coleridge au livre XIII de sa Biographia Literaria – la même idée que Baudelaire défend dans un chapitre célèbre du Salon de 1859, et qui est peut-être passée par Edgar Poe – « faculté synthétique et magique » que son mouvement vers l’unité préserve des caprices de la fantaisie et du fantasme. La relation spéciale que Stephen Romer entretient avec la poésie française apparaît non seulement dans le nombre des allusions à des « réalités disponibles » qui en proviennent, mais dans la façon dont il nous fait aborder, par ce livre bilingue, la question de la traduction. Si l’Imagination est bien ce pouvoir qui fait participer les œuvres vraiment poétiques d’un même logos, n’est-ce pas ce pouvoir également qui rend possible, et même naturel, l’acte de traduire, dans les limites du mouvement vers l’unité accompagnant les réalités vécues du poème ? L’admirable poème « Oxford » (dans « Les yeux mi-clos »), en apporte la preuve, évoquant une conversation, qu’on devine identiquement sur le poème et sur la traduction, avec Michael Sheringham, qui fut le professeur de Stephen Romer : s’agissant de définir une nuance de jaune, l’essence d’un arbre, la forme exacte d’un effet de la lumière, de les redire ou revivre au passé ou au présent, réalité ou langage, le vertige du « mot juste » y conduit à une « question de vie ou de mort » – qui est vie ou mort du poème. La traduction du livre, travail commun entre l’auteur et ses deux fidèles traducteurs, Gilles Ortlieb et Antoine Jaccottet, est le fruit d’un pareil souci du mot juste – quand il s’agit de trouver ce qui en français peut correspondre à tel mot anglais précisément choisi pour le degré de réalité auquel peut prétendre atteindre la nuance qu’il propose, et qui n’a de sens que vécue.
Ainsi la traduction est-elle vérifiée (sans que soient effacées pour autant les différences entre les deux langues, ici plus rapide et rythmique, là plus analytique et narrative), faisant de ce livre, avec toutes les richesses qu’il contient, un monument de poésie remarquable et durable – si de tels qualificatifs ne paraissent pas trop lourds au parfait ironiste (kierkegaardien) qu’est Stephen Romer.
Par François Lallier
