Poezibao, "La vie même", par Gérard Cartier
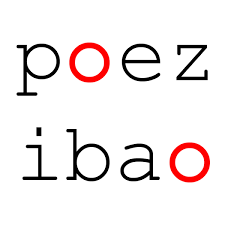
Peu de poètes qui le soit aussi naturellement qu’Emmanuel Moses. Son vers semble s’exhaler sans effort, épousant aussitôt sa matière. La vérité de l’instant lui importe plus que la perfection de la forme. Il reprend donc peu ses poèmes, qu’il livre aussitôt à l’édition – trois recueils en 2020 –, laissant les lecteurs y puiser à leur goût. Son tempérament le porte au jeu des confidences. Pour le fond de mélancolie qui imprègne ses pages, et pour leur élégance, il s’inscrit dans la longue lignée des poètes élégiaques. Il s’en démarque par une obsédante inscription dans l’Histoire : l’inspiration saturnienne atteint son acmé lorsqu’il évoque les persécutions des juifs, au siècle dernier – ou dans le grand passé. Ces remémorations, profondément intériorisées, sont certainement la partie la plus originale de son œuvre. Caractériser, c’est schématiser. Il faudrait dire aussi sa fantaisie, sa sensualité, son penchant à l’absurde et au burlesque – et il ne recule pas à l’occasion devant une réflexion plus abstraite, qu’on pourrait qualifier de métaphysique (un alter ego, Monsieur Néant, passe ainsi de livre en livre), si elle n’était toujours incarnée.
*
C’est dans cette veine spéculative que s’inscrit Quatuor. Le titre lorgne vers T. S. Eliot, auquel il est emprunté, de même que l’organisation quadripartite et l’apparence du propos. Mais c’est Burns Singer, le poète des Sonnets pour un homme mourant, qui fournit l’épigraphe (« ...nos mots pourrissent / Par un mystère que nous ne saurions dire », selon la belle traduction d’Hubbard et Maury, Obsidiane, 2017), ce qui donne à ce livre une tout autre tonalité. Du reste, nulle transcendance ici, aucun dieu, malgré les fréquentes références à la Bible, dont les vieilles images relèvent d’une mythologie native. Rien, dans le théâtre du monde, qui ressemble à un dessein supérieur, les cintres sont vides,
Pas de costumiers, d’éclairagistes, de décorateur
Mais surtout pas de souffleur !
Le trou est vide
Et pas de bougies dans le trou du souffleur !
Il y a de l’Épicure chez Moses – il s’inspire d’ailleurs de l’un des passages les plus célèbres du De rerum natura pour s’assimiler aux particules qui virevoltent dans un rayon de soleil. Le chaos règne sur la scène, « la matière soumise à tous les aléas ». Délivré de toute nécessité, de rôle, de texte, d’indications de jeu, l’homme est donc libre, d’une liberté fille du hasard, qui ne résout rien : car elle peut être « décision ou résignation », agissante ou passive, et le refus d’agir est lui-même agissant... La pensée irritante qui cherche à prendre forme, le vertige métaphysique qui l’engendre, l’angoisse même (« être c’est mourir »), l’auteur s’en arrache à la fin d’un coup de talon, les sublimant en un credo épicurien : « Déployez la rose de vos cinq sens. »
Nous voilà assez loin de la manière lyrique. Un lecteur bas-dauphinois pourrait se sentir médiocrement concerné. Mais Moses n’est pas Eliot. Rien de didactique dans cette méditation, qui est enracinée dans le réel. Tout la sollicite, tout lui est adressé, tout être de rencontre cache « un Hermès de fortune ». La pensée erre, capricante, saisissant la circonstance pour se déployer, l’enterrement d’un ami (le poète Paul Le Jéloux), une cloche au loin sonnant l’angélus, le souvenir des amants enlacés exhumés des cendres de Pompéi. La réflexion est incrustée de vignettes colorées qui retiennent l’esprit le moins porté à la métaphysique. Ainsi des portraits funéraires du Fayoum :
J’ouvre le livre des anciens visages de l’Égypte
Et je les écoute
Ils me parlent de la mort et de sa morsure
De l’éternité qu’elle fait sourdre de la chair du temps
Et comme je les en remercie, ces très vieux morts
Peints à l’encaustique sur les sarcophages en bois de tilleul
Ou peints à la détrempe sur des sarcophages en bois d’if, en bois de sycomore Peints sur des masques de plâtre et sur des voiles en lin
Ces hommes, ces matrones, ces jeunes filles, ces enfants Prenant éternellement congé de nous
Sur les vertes collines des adieux.
Et comment se refuser à l’évocation de Jérusalem, qui fait l’essentiel du 3e mouvement ? Jérusalem « abandonnée par ses prophètes », où le passé affleure à chaque pas, peuplant la mémoire et, la ligne de l’âge franchie (celle de la soixantaine), semblant dévorer la vie :
Je marchais dans ce mélange de climats et de lumières
De temps lointains mal ajointés
Imbriqués, enchevêtrés, entre-pénétrés (...)
Plus j’avance en âge, plus mon présent sert de combustible au passé L’un se consume, dirait-on, pour alimenter l’autre
La cendre paie pour les flammes
Un sacrifice destiné à affranchir ce qui n’est plus Plus qu’ombre et cohorte d’ombre
mais où l’interrogation existentielle ne s’affranchit pas du monde sensible. Et, dans ce « royaume d’Outremer » saturé d’images et de couleurs, la mélancolie ne grève pas la joie prônée par les Psaumes. La touche d’exotisme est légère : le passant de Jérusalem ne se distingue pas du passant de Paris – royaume d’ici que des signes épars (GAZ À TOUS LES ÉTAGES !) ramènent à son origine, lui rappelant douloureusement les spoliations et les crimes, Drancy, Auschwitz ; lui rappelant aussi que Paris, « rouge comme l’étoile jaune », est la ville de Manouchian et des FFI. Ce 3e mouvement, avec son cours vagabond, tour à tour vif et pensif, reste longtemps en mémoire.
*
[…]
À propos de l’écriture d’Emmanuel Moses, j’ai parlé plus haut de son vers. Je crains que ce mot ne trompe. Car il a coulé ses poèmes dans la plupart des formes existantes, de la prose (Polonaise, Flammarion, 2017) au vers dit justifié cher à Ivar Ch’vavar (Les Bâtiments de la Compagnie Orientale, Obsidiane, 1993), en passant par les courtes incisions de Métiers (Obsidiane, 1989) et les strophes démaillées de certains poèmes de L’Animal (Flammarion, 2010), par exemple – quoiqu’il manifeste une évidence prédilection pour le vers libre, qui donne forme à ses derniers recueils. Comme la vie même.
Par Gérard Cartier
