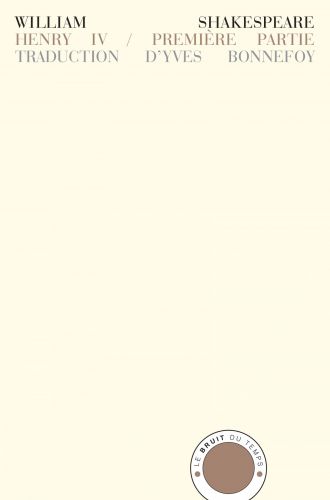La Mer et le Miroir / Commentaire de La Tempête de Shakespeare
W. H. Auden
Édition bilingue
Traduction de l’anglais et présentation
par Bruno Bayen et Pierre Pachet
Format : 135 x 205 mm
160 pages
ISBN : 978-2-35873-002-0
Mise en vente : 17 avril 2009
C’est après avoir émigré aux États-Unis que W.H. Auden, qui a déjà derrière lui une œuvre poétique considérable, compose entre 1942 et 1944 son poème dramatique La Mer et le Miroir. Il s’agit à la fois d’une continuation et d’un commentaire de la dernière pièce de Shakespeare, La Tempête, œuvre-testament dans laquelle le poète élisabéthain a donné – à travers une intrigue fantastique – un résumé énigmatique de sa pensée et de son théâtre. Dans La Mer et le Miroir, les personnages de la pièce, après une représentation, reviennent tour à tour sur scène pour commenter, chacun dans une forme poétique qui lui est propre, le spectacle auquel le public vient d’assister.
La Mer et le Miroir est un chef-d’œuvre, aussi bien par l’intelligence critique qu’y déploie Auden que par sa virtuosité de poète, en tous points digne de l’œuvre qu’il commente. Comme Auden l’a lui-même dit à ses amis : « C’est mon art poétique, de la même manière que, je le crois, La Tempête fut celui de Shakespeare. »
Et c’est cela qui est particulièrement émouvant, dans ce poème écrit pour la scène. À la fin d’une «tempête» qui ne fut que trop réelle, la Seconde Guerre mondiale qui l’a exilé loin de son pays, Auden, dont une grande part de son œuvre est déjà derrière lui, décide de méditer sur ce que signifia, pour Shakespeare, écrire une ultime pièce avant de renoncer à son art. Loin de voir dans La Tempête, comme Henry James, une pièce où Shakespeare se serait contenté d’offrir à son public comme à lui-même l’exemple le plus pur et le plus rare de son art littéraire, Auden a le coup de génie de donner à Caliban le dernier mot, au cours d’un long discours écrit dans une prose aussi subtile que celle de James. Il a compris que l’art n’est pas un sanctuaire, qu’il est le lieu où la vie la plus réelle peut se confronter à son reflet et que seuls les échanges constants de l’un à l’autre permettent de parvenir à quelque chose comme une « relation restaurée ».
Si Auden est si mal connu en France, c’est aussi parce qu’il est un poète d’une grande maîtrise formelle, un artisan virtuose de son art. Il est donc particulièrement difficile à traduire. Pierre Pachet, depuis toujours particulièrement sensible à l’art de traduire, et Bruno Bayen, qui possède une précieuse pratique de l’art du théâtre, sont parvenus à rendre toutes les nuances de sens d’un texte d’une grande complexité, tout en créant un poème français presque aussi musical que l’original anglais, que l’on peut lire ici en regard de la traduction.
En savoir plus sur La Mer et le Miroir :
C’est après avoir émigré aux États-Unis que W.H. Auden, qui a déjà derrière lui une œuvre poétique considérable, compose entre 1942 et 1944 son poème dramatique La Mer et le Miroir. Il s’agit à la fois d’une continuation et d’un commentaire de la dernière pièce de Shakespeare, La Tempête, œuvre-testament dans laquelle il semble que le poète élisabéthain ait donné – à travers une intrigue fantastique – un résumé énigmatique de sa pensée et de son théâtre. Le poème est publié en 1944, avec un autre long poème, For the Time Being : a Christmas Oratorio [Pour le Temps présent, un Oratorio de Noël], dédié à la mémoire de la mère du poète, récemment disparue.
Dans la pièce de Shakespeare, Prospero, qui pour se consacrer à ses livres et à l’art qu’ils lui inspirent, a renoncé à son duché de Milan au profit de son frère, l’usurpateur Antonio, règne sur une île où, avec l’aide de l’esprit Ariel, il suscite toutes sortes de prodiges, de visions, de charmes. C’est lui qui déclenche la tempête qui fait naufrager le bateau sur lequel étaient embarqués Antonio, mais aussi le roi de Naples Alonso, son fils Ferdinand et son frère Gonzalo, et qui mène l’action, en mettant en scène le spectacle destiné à la fois à redresser les injustices commises et à instruire les rescapés et le public sur la nature « insubstantielle » de ce qu’ils ont vu, et sur leur propre nature analogue à celle des rêves.
Dans La Mer et le Miroir, en revanche, c’est d’abord un organisateur du spectacle resté anonyme, qui – en guise de « Préface » – s’adresse aux critiques (ceux de Shakespeare, en particulier). Il est donc lui-même un poète, Auden sans aucun doute, parlant en son propre nom.
Le poème est ensuite divisé en trois chapitres.
Le premier chapitre voit Prospero faire ses adieux à son fidèle serviteur Ariel, comme il le fait dans la dernière scène de La Tempête, tenant ainsi sa promesse de le libérer une fois sa tâche accomplie. En faisant parler Prospero, Auden l’analyse, fait voir en lui non pas simplement la victime d’une usurpation, mais celui qui a « poussé Antonio à [le] trahir » ; non pas seulement le maître d’Ariel – esprit qui invente les détails concrets à travers lesquels l’imagination de l’écrivain parvient à des situations et des formes concrètes – mais aussi celui qui a formé avec son serviteur un couple presque pervers fondé sur la dépendance mutuelle ; non pas seulement le maître de Caliban, mais le responsable de sa dégradation. Au moment où le fidèle Gonzalo vient le chercher pour lui faire quitter la scène, disant adieu à Ariel, à son île, à ses livres et à ses pouvoirs magiques, disant aussi adieu à son enfance et à sa vie d’homme, le Prospero d’Auden se prépare à la vieillesse, à la mort et au désespoir.
Le second chapitre consiste en une série de poèmes de formes différentes (une sorte de tour de force artistique) prononcés par les personnages secondaires de la pièce. Dominant ce chapitre, l’Antonio de La Mer et le Miroir s’affirme presque comme l’égal de Prospero, en tout cas comme à même de le remettre à sa place, de faire voir les limites de la grandeur de son frère. Mais tous les personnages se succèdent, y compris le sommelier ivrogne, Stephano, une sorte de Falstaff, en une ballade qui évoque le couple qu’il forme avec son ventre, et la dualité de chacun – dualité qui est un thème majeur de la pièce.
Le troisième chapitre, qui voit Caliban s’adresser au public, est en prose, une prose alambiquée, en longues phrases où les critiques voient volontiers l’imitation de celles de Henry James, lui-même auteur d’un essai sur La Tempête. La surprise, le renversement qu’opère Auden, est que ce soit l’indigène de l’île, celui que Prospero avait déclaré inéducable, « esclave difforme, fils d’une sorcière », plein de ressentiment, que ce soit lui qui prenne la parole une fois le rideau baissé, à la place de l’auteur lui-même, pour tirer devant le public les leçons de la pièce et de l’œuvre. Il le fait avec beaucoup de lucidité et d’art, avec des ressources d’imagination et d’intelligence dans lesquelles on ne peut que reconnaître les vertus d’Auden essayiste, ses aptitudes critiques et théoriciennes telles qu’elles apparaissent dans ses essais sur Shakespeare, sur l’opéra, sur le roman policier ou sur la littérature en général. Donnant la parole à Caliban en ce moment de sa pièce, Auden démet Prospero de son rôle magistral (et de sa prétention à l’innocence). Il reconnaît aussi son propre côté Caliban, le lien qui existe entre son talent ou son intelligence, et une sorte de monstruosité énigmatique qui l’anime.
Caliban commence par expliquer, après la représentation, pourquoi c’est lui, et non l’auteur, qui prend la parole. Il est le mieux à même de donner forme aux pensées informulées des spectateurs, aux critiques qu’ils font à la pièce de Shakespeare, à celui en particulier de l’avoir introduit, lui un monstre, l’ennemi de la muse, face à Ariel, qui est la fantaisie et l’art. À ces reproches, Caliban répond d’abord en prenant la parole au nom de l’auteur s’adressant aux futurs poètes, dramaturges ou écrivains venus voir la pièce pour y puiser un enseignement sur ce qu’est la création littéraire et dramaturgique. Caliban décrit alors avec brio le couple que forment le créateur et l’esprit qui donne corps à ses fantaisies, un couple qui se transforme avec le temps, jusqu’au moment où derrière Ariel serviable et disponible apparaît un être révolté et épris d’indépendance, qui n’est autre que Caliban lui-même. Dans la dernière partie de son allocution, Caliban s’adresse enfin au public en général en lui rappelant le chemin qu’il a parcouru pour sortir du charme de l’enfance et faire face au désenchantement de la vie réelle, brillamment évoquée par une multiplicité de touches réalistes. Le travail du dramaturge, dit-il, a été à la fois de représenter la vie dans sa médiocrité, et d’évoquer faiblement ce qu’elle pourrait être, ou aussi bien, à travers une œuvre imparfaite et imparfaitement représentée, de faire imaginer ce que serait l’Œuvre accomplie.
Un « post-scriptum » clôt la pièce, en trois strophes lyriques : Ariel y prend la parole pour la première fois, s’adressant à Caliban, et affirme quasi amoureusement le lien qui unit les deux personnages antithétiques, corps et esprit, boiterie et légèreté aérienne dont la séparation est la mort. L’écho que renvoie le souffleur à chaque fin de strophe est comme le signe évanescent de la fragilité de leurs existences.
Ce résumé, emprunté à la postface de Pierre Pachet, devrait suffire à en donner une idée : La Mer et le Miroir est un chef-d’œuvre, aussi bien par l’intelligence critique qu’y déploie Auden que par la virtuosité du poète, en tous points digne de l’œuvre qu’il commente. Comme Auden l’a lui-même dit à ses amis, en parlant de ce poème : « C’est mon art poétique, de la même manière que, je le crois, La Tempête fut celui de Shakespeare. »
Et, de fait, c’est cela qui est particulièrement émouvant dans ce poème écrit pour la scène. Auden est alors l’un des plus grands poètes anglais, une grande part de son œuvre – que beaucoup considéreront comme la plus importante – est déjà derrière lui. À la fin d’une tempête qui ne fut que trop réelle, la Seconde Guerre mondiale qui l’a exilé loin de son pays, et après la mort de sa mère, il décide de méditer, de la façon la plus concrète, la plus intelligente aussi, sur ce que signifia, pour le plus grand poète de sa tradition littéraire, Shakespeare, d’écrire une ultime pièce avant de renoncer à son art. Loin d’y voir, comme Henry James, une pièce où Shakespeare se serait contenté d’offrir à son public comme à lui-même l’exemple le plus pur et le plus rare de son art littéraire, Auden a bien compris que l’art n’est pas un sanctuaire, qu’il est le lieu où la vie la plus réelle peut se confronter à son reflet et qu’il faut ces échanges constants entre l’art et la vie sous toutes ses formes pour parvenir à quelque chose comme une « relation restaurée ».
À la fin du discours de Caliban, Auden préfigure le théâtre de Beckett :
« Pourtant, en ce moment précis où nous nous voyons enfin nous-mêmes tels que nous sommes, ni à l’aise ni folâtres, mais sur l’ultime corniche battue des vents qui domine le vide sans fin — nous ne nous sommes jamais tenus ailleurs —, alors que nos raisons sont réduites au silence par l’énorme dérision — Il n’y a rien à dire. Il n’y a jamais rien eu à dire — et que nos volontés tremblent entre leurs mains — Il n’y a pas d’issue. Il n’y en a jamais eu —, c’est à ce moment que pour la première fois de nos vies nous entendons non pas les sons que, acteurs-nés que nous sommes, nous avons jusqu’ici condescendu à utiliser comme un excellent médium pour mettre en valeur nos personnalités et notre allure, mais la Parole réelle qui est notre seule raison d’être. »
Pour laisser un commentaire, veuillez vous connecter à votre compte client.